< retour aux articles
1 an à University of Michigan pour Valentin
Publié le
Il y a un an, Valentin a choisi de candidater à l’Université du Michigan. Il a pu bénéficier d’une bourse de mobilité pour une formation diplômante de la part de la Fondation afin de réaliser un Master of Science in Climate and Space Sciences.
Il vous raconte son séjour !

Pourquoi avoir choisi l’Université du Michigan ?
J’ai décidé de candidater à l’University of Michigan pour de nombreuses raisons. Grâce à ma scolarité à l’ISAE-SUPAERO, j’ai acquis des bases solides en ingénierie appliquée au spatial, mais j’avais aussi la volonté de compléter ma formation par des cours davantage axés vers la recherche. Également, je voulais orienter mes études à la fois vers les sciences planétaires et la physique du climat. C’est dans cette perspective que je me suis intéressé au Master of Science in Climate and Space Sciences, à l’University of Michigan, parce qu’il correspondait parfaitement aux domaines dans lesquels je voulais me spécialiser. Ce Master, orienté vers la recherche, me permettait aussi de constituer un socle solide me permettant de poursuivre en doctorat, et, à terme, de contribuer à des missions d’exploration planétaire.
J’ai aussi choisi ce Master, car j’étais attiré par son programme original, qui mêle recherche scientifique et innovation technologique. Il est en effet possible d’étudier différent domaine de la recherche appliquée, à la fois les atmosphères planétaires, les caractéristiques du vent solaire, les champs magnétiques ou encore le climat terrestre et la géophysique. Ces cours orientés sur la physique fondamentale, la mécanique et la mécanique des fluides, viennent compléter d’autres classes plus orientées sur l’ingéniérie spatiale, souvent sous forme de projet en lien avec l’industrie spatiale américaine, pour appliquer concrètement les notions étudiées. Ainsi, dans le cadre d’un cours, j’ai eu l’opportunité de travailler sur le projet Uranus Orbiter and Probe avec la NASA !
Enfin, mon projet était également motivé par des raisons plus personnelles. J’avais toujours eu l’envie de passer une année à l’étranger, dans le cadre de mes études, pour découvrir une culture et un environnement académique différents du mien. J’étais particulièrement attiré par les pays d’Amérique du Nord, notamment les États-Unis, pour leur diversité culturelle, leur dynamisme universitaire et leurs prestigieuses universités. J’avais à cœur de découvrir un autre mode de vie, de faire de nouvelles rencontres et d’expérimenter un système éducatif différent. Cette expérience m’a effectivement permis d’élargir mes horizons, tant intellectuellement qu’humainement.
Comment s’est déroulée ton année sur le plan académique ?
Valentin Oncle
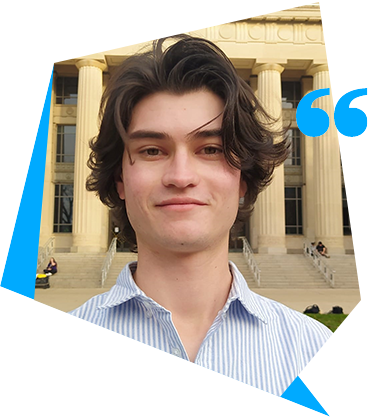
Mon année à Ann Arbor a été intense, exigeante, mais surtout incroyablement enrichissante. J’ai choisi de suivre ce Master en seulement deux semestres, alors qu’il est normalement prévu pour trois, voire davantage. Ce choix m’a demandé une charge de travail importante que j’ai pleinement assumée. En parallèle de mes cours, j’ai aussi travaillé comme assistant de recherche au sein du département de Climate and Space Sciences and Engineering, sous la direction du professeur Xianzhe Jia, un spécialiste des magnétosphères planétaires. Mon travail portait plus précisément sur un code de simulation du vent solaire dans le système solaire.
Sur le plan académique, le programme s’est révélé très stimulant, avec des cours variés couvrant un large éventail de thématiques. J’ai suivi un cours de planétologie, celui qui m’attirait le plus. On y a abordé la formation des planètes, leur évolution, leur dynamique interne et atmosphérique, ainsi que l’étude des exoplanètes. J’y ai mené un projet sur la dynamique de la Grande Tache Rouge de Jupiter. J’ai également suivi un cours très complet sur la dynamique des fluides géophysiques, et un autre consacré au champ magnétique terrestre, mais aussi à l’étude de Soleil et les impacts des éruptions solaires sur la Terre.
Enfin, un cours plus orienté ingénierie nous apprenait à concevoir une mission spatiale de A à Z, en particulier une mission interplanétaire. L’examen final consistait à réaliser la mission d’un satellite d’observation de la Terre en moins de 100 heures : il s’agit de tout concevoir, depuis la rédaction d’un ordre de mission décrivant les objectifs scientifiques de la mission jusqu’aux composants précis de l’électronique ou du système de refroidissement du satellite ! C’est aussi dans ce cadre que j’ai eu l’opportunité de travailler avec la NASA sur le projet Uranus Orbiter and Probe. Au second semestre, j’ai poursuivi avec un cours sur la dynamique des fluides de l’atmosphère, qui était dans la continuité de ceux du semestre précédent, mais qui introduisait en plus des notions de dynamique des océans. Également, on y a étudié certains phénomènes climatiques, comme les cyclones, le Jet Stream ou encore la physique des nuages.
Dans ce Master, on devait également suivre quelques cours en dehors du département principal. Plus j’avançais dans le programme, plus je me rendais compte que, même si les thématiques abordées m’intéressaient beaucoup, ce qui m’attirait vraiment, c’étaient les mathématiques et l’intelligence artificielle. À force de discussions avec certains professeurs et de recherches personnelles, j’ai découvert un champ en plein essor : l’application des maths et de l’IA aux sciences planétaires et à la physique du climat. Par ailleurs, j’ai réalisé que la conception de missions spatiales m’attirait moins que prévu. Trop orienté ingénierie à mon goût (je suis plus du côté scientifique).
Durant le second semestre, j’ai donc choisi d’ajouter à ma formation, différents cours du département de mathématiques : analyse complexe, processus stochastiques, systèmes dynamiques… J’y ai notamment mené un projet intitulé « Can a volcano turn the Earth into a snowball?! », dans lequel je montrais, à l’aide d’outils mathématiques appliqués à la physique du climat, qu’une (très) grosse éruption volcanique pouvait théoriquement plonger la Terre dans un super âge glaciaire !
Enfin, plus généralement, j’ai beaucoup apprécié la pédagogie à l’américaine : peu d’heures de cours, mais beaucoup des projets concrets et de DM, et une vraie volonté de donner du sens à ce qu’on apprend.
Ainsi, sur le plan académique, tout s’est très bien passé. Un temps a été lorsque j’ai assisté à des conférences de chercheurs et doctorants en planétologie provenant de différentes universités américaines, et qui traitaient de sujets que je trouve passionnant : l’étude de la géologie et de l’atmosphère de Mars, d’astéroïdes, et même aussi la recherche d’exolunes (des lunes autour d’exoplanètes). C’est celle sur Mars qui m’a le plus intéressé, ou` j’avais pu en discuter plus en détail avec la doctorante de l’University of Colorado at Boulder qui l’avait présentée.
Quel bilan tires-tu de ce séjour sur le plan personneL ?
Sur le plan personnel, cette année a aussi été riche en découvertes. L’université est située à Ann Arbor, une petite ville universitaire à taille humaine, très agréable à vivre, avec une forte vie étudiante et une ambiance internationale. Le campus m’a rappelé par moments les universités anglaises, composé de bâtiments modernes imposants. Le stade, immense (110 000 places !) m’a particulièrement marqué. Ainsi, un premier temps fort de l’année a été lorsque quelques jours après la rentrée, j’ai assisté au match d’ouverture de la saison de football américain. Le stade était plein, l’ambiance électrique, et l’équipe venait tout juste de remporter le championnat national.
Deux autres moments forts de mon séjour, hors cadre universitaire cette fois, ont été la visite de ma copine fin octobre, l’occasion de lui faire découvrir Ann Arbor, et, à la toute fin de mon année, ma visite à une amie en stage à Harvard, qui m’a fait découvrir Harvard et Boston.
Ce séjour m’a énormément apporté, sur de nombreux plans. Sur le plan académique, j’ai pu me former en profondeur dans des domaines variés comme la planétologie, la dynamique atmosphérique, la physique du vent solaire, mais aussi en analyse complexe et en processus stochastiques. J’ai mené plusieurs projets dans le cadre de mes cours, ce qui m’a permis d’explorer des applications concrètes des nouvelles connaissances acquises. Cette année m’a aussi aidé à faire le lien entre ma formation d’ingénieur et les exigences d’un travail de recherche, qu’il soit appliqué ou fondamental.
Par ailleurs, mon travail en tant qu’assistant de recherche auprès de Xianzhe Jia a été très formateur. J’y ai appris ce que signifie concrètement travailler dans la recherche, comment les projets sont menés, et ce qu’implique une démarche scientifique sur le long terme.
Cette année m’a également permis de mieux comprendre certaines différences culturelles et pédagogiques entre la formation française et la formation américaine. J’ai réalisé que, contrairement à nous, les étudiants américains suivent souvent des parcours très spécialisés : certains se concentrent uniquement sur la mécanique, d’autres sur l’électronique, les mathématiques ou la physique, mais rarement sur l’ensemble de ces disciplines. À l’inverse, notre formation à l’ISAE-SUPAERO nous donne une vision large et interdisciplinaire : nous touchons à beaucoup de domaines scientifiques et techniques, ce qui nous confère une solide culture scientifique générale.
Cela dit, j’ai aussi constaté que les étudiants américains sont souvent mieux formés que nous sur les aspects pratiques liés à la conduite de projets, qu’ils soient scientifiques ou d’ingénierie. Ils maîtrisent davantage les méthodes d’organisation, de gestion d’équipe ou de planification, et sont plus à l’aise avec la dynamique des projets de recherche collaboratifs. Ce n’est pas quelque chose dont j’avais pleinement conscience avant, mais cette année m’a permis de le constater de manière très concrète.
Avec le recul, je suis convaincu que combiner un diplôme d’ingénieur d’une grande école française et un Master scientifique américain est une réelle richesse. Cela permet de réunir à la fois une base scientifique large et rigoureuse, et une approche plus appliquée, plus structurée et souvent plus orientée vers le travail en équipe.
Ce séjour t’as permis de confirmer tes aspirations professionnelles ?
Sur le plan professionnel, cette année m’a permis de préciser et d’affiner mes objectifs. Je souhaite désormais me spécialiser dans l’application des mathématiques et de l’intelligence artificielle à la physique du climat et à la planétologie. Ce sont des thématiques que j’ai découvertes progressivement au fil des cours, des échanges avec des enseignants, et des projets auxquels j’ai participé.
Je vais poursuivre cette orientation dès cet été, avec un stage de recherche au CNES à Toulouse, plus précisément au LEGOS (Laboratoire d’Études en Géophysique et Océanographie Spatiale). Ce stage portera sur l’étude du réchauffement des océans, un phénomène clé du changement climatique. Pour cela, j’utiliserai des outils issus des mathématiques appliquées.
C’est, à mes yeux, une excellente manière de conclure cette année. Je suis heureux que ce stage me permette à la fois d’approfondir mes compétences scientifiques et de contribuer, même modestement, à une meilleure compréhension d’un enjeu aussi fondamental que le changement climatique.
L’an prochain, je terminerai ma formation à l’ISAE-SUPAERO. Il y a un an, j’hésitais encore à prendre la filière OTSU (Observation de la Terre et Sciences de l’Univers) ou la filière SDD (IA et Sciences de la Donn´ees) en guise de spécialisation pour cette dernière année, mais les réflexions de cette année autour de mon avenir professionnel m’ont finalement poussé à choisir SDD. C’est également le fait que me MSc in Climate and Space Sciences couvrait déjà une bonne partie de ce qui est abordé dans la filière OTSU qui a consolidé ce choix. En dernière année à Supaéro, nous devons aussi choisir un domaine d’application, pour lequel j’ai choisi les mathématiques appliquées avec le domaine SXS. Et en parallèle, je vais suivre le Master 2 de Mathématiques Appliquées à l’Université Paul Sabatier, afin de consolider encore davantage mes bases théoriques en mathématiques.
Enfin, je me prépare à poursuivre en doctorat. J’aimerais que celui-ci soit centré sur les mathématiques, tout en comportant une forte dimension appliquée à la physique du climat ou à la planétologie. Je n’ai pas encore arrêté de sujet précis : j’espère que ma dernière année à l’ISAE-SUPAERO m’aidera à y voir plus clair. Je n’exclus pas non plus de repartir à l’étranger pour ce doctorat — peut-être en Europe, ou ailleurs — même si le contexte politique actuel me rend plus hésitant concernant les États-Unis. Pour ce projet de doctorat particulier, je suis convaincu que me MSc in Climate and Space Sciences que je viens d’effectuer à l’University of Michigan sera aussi un vrai plus, parce qu’un certain nombre d’étudiants ont des parcours d’études en mathématiques ou en sciences du climat, mais rarement dans les deux à la fois.
Quel bilan dresses-tu de cette année aux Etats-Unis ?
En conclusion, cette année à l’University of Michigan a été une expérience exceptionnelle, au cours de laquelle j’ai énormément appris, tant sur le plan académique que personnel.
Elle m’a permis de mieux cerner ce qui m’intéresse vraiment d’étudier, tout en me donnant une formation solide et enrichissante. Mais aussi, ce programme constitue une réelle valeur ajoutée pour mon futur parcours, non seulement pour les connaissances acquises dans le domaine de la recherche, mais aussi pour les enseignements scientifiques que j’en retire.
Un mot de la fin ?
Je souhaite adresser un immense merci à la Fondation de m’avoir accordé ce financement, qui m’a permis de réaliser ce séjour qui aura un impact significatif sur ma vie.
Aux donateurs, je souhaite les remercier de croire en de jeunes étudiants en leur accordant une aide financière, souvent précieuse.
J’espère un jour, moi aussi, être donateur pour la Fondation, et aider des étudiants à réaliser des rêves.